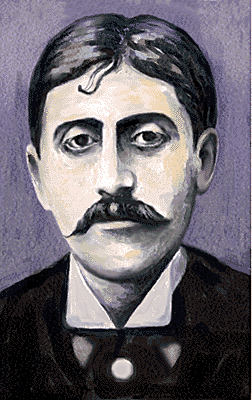
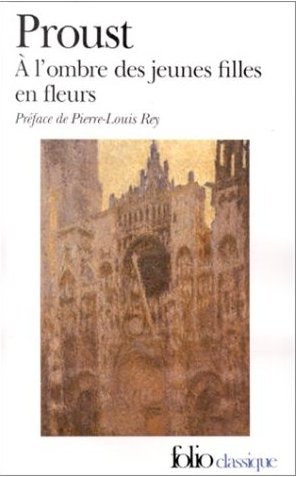
Le billet à Claudine de Michel BOUDIN
Marcel PROUST (Art et rédemption)
Nous étions très nombreux, jolie cousine, ce dimanche 16 mars, à être venus écouter M. Bruno VIARD, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, qui nous parla de PROUST, à partir de "A l'ombre des jeunes filles en fleur".
On croit toujours tout savoir sur PROUST, Claudine, et on pense un peu facilement en avoir fait le tour quand on a évoqué la trop célèbre petite madeleine et le déroulement infini de ses phrases à subordonnées gigognes.
Mais qu'un lecteur averti, doué d'un grand talent professoral tel que celui de M. VIARD, s'en empare et voila que se dessine sous nos yeux le profil d'un auteur d'une richesse et d'une profondeur qui nous paraissent insondables.
Le coeur du propos toucha les rapports existant entre l'Art et la Vie et la façon dont l'un pouvait peut-être sauver l'autre.
"L'art qui permet de convertir la douleur en beauté".
"La vraie vie, nous dit PROUST, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent vécue, c'est la littérature."
On peut, cousine, ne pas acquiescer à cette conclusion brutale mais force est de reconnaitre qu'elle éveille en nous bien des échos.
MALRAUX par exemple:"Chacun des chefs-d'oeuvre de l'art est une purification du monde."
Ou encore: "Les arts ont lié l'homme à la durée sinon à l'éternité et tendu à faire de lui autre chose que l'habitant comblé d'un univers absurde".
On connait aussi: "L'art est un anti-destin".
On peut penser également à KUNDERA et à sa légèreté de l'être". Légèreté si totale qu'elle en serait "insoutenable" sans le secours de l'art.
Voila, Claudine, de spensées bien sévères en cette approche du printemps. Tu voudras bien ne pas en tenit rigueur à ton cousin.
FLORENTIN
Le compte-rendu de Monique BECOUR pour "A l'ombre des jeunes filles en fleur"
Le dimanche l6 Mars 2008, nous étions réunis, assemblée maximum, à la Brasserie Massilia afin d'écouter Monsieur Bruno VIARD, Professeur en Littérature, Philosophie, Psychologie politiques à l'Université d'Aix Marseille, nous parler de l'amour et « du baiser volé » dans l'œuvre de Marcel Proust.
Mr VIARD qui sort très prochainement en librairie, un opuscule « La littérature ou la vie ! » sous titré « Mauss lecteur de Proust » aux Editions Ovadia, s'est volontairement limité à ce thème du « baiser volé », à partir de l'expérience de l'enfance : le baiser donné chaque soir ou non par la mère, - non donné lorsque la famille Proust reçoit des invités, parmi lesquels Swann, - donc un sevrage raté provoquant un concentré de nœuds affectifs chez l'enfant frustré, difficile à élever, jamais satisfait ensuite lorsqu'il découvre les jeunes filles.
Mr Viard a beaucoup insisté sur l'expérience toujours décevante pour le jeune Marcel car si le baiser est donné par la mère, malgré qu'elle le lui ait refusé plus tôt dans la soirée, il se reproche ensuite qu'elle lui ait cédé. Provoquant ainsi une double expérience de l'angoisse car l'objet empêché puis en deuxième lieu, donné. « L'angoisse de l'attente de la mère est la matrice…des attentes amoureuses futures. » (cf. B.Viard, p22).
Le deuxième baiser volé est celui qu'il tente auprès d'Albertine, dans la chambre de la jeune fille au Grand Hôtel de Balbec (le Grand Hôtel de Cabourg où Proust loue toujours quatre chambres) : c'est elle qui a invité le héros à monter alors qu'elle est déjà couchée.. Il s'était dit, le naïf, « que ce n'était pas pour ne rien faire, qu'une jeune fille, fait venir un jeune homme en cachette, en s'arrangeant pour que sa tante ne le sache pas, que d'ailleurs l'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions, « etc. etc.(cf.p.333, JFF)
Approchant ses lèvres de la joue, il entendit un son précipité, prolongé : « Albertine avait sonné de toutes ses forces . » !
Je fis remarquer que dans le premier tome des JF en fleurs, est décrit un épisode bien plus érotique et abouti (p.157-158), le jeune Marcel qui rejoint Gilberte chaque après midi dans les jardins des Champs Elysées pour des jeux (barres, etc) se voit subtiliser une lettre de Swann, le père de Gilberte, qui lui est destinée. La jeune fille assise, « aux joues rouges et rondes » lutte et se penche en arrière, lettre à la main : « je la tenais serrée entre mes jambes comme un arbuste après lequel j'aurais voulu grimper,…..je répandis comme quelques gouttes de sueur arrachées par l'effort, mon plaisir auquel je ne pus pas même m'attarder le temps d'en connaître le goût » ! Gilberte, naïve ? plutôt perverse, lui propose de recommencer ! Quel âge a le jeune Marcel ? Difficile de répondre à cette question. Cependant, sur une photo le jeune Albert Proust, Gilberte et un troisième garçon posent au Parc Monceau, âgés d'environ treize, quatorze ans.
Pour revenir au baiser donné à Albertine, il faudra attendre « Du côté de Guermantes » pour qu'il soit réalisé, chaque soir, sur la joue, sur le grain de beauté, toujours le lien avec Maman.
Notre groupe a apprécié l'humour de l'homme Marcel Proust avec l'épisode de la potiche chinoise, héritée de la tante, vendue pour que le héros Marcel puisse se rendre avec son copain de lycée, Bloch, dans une maison de passe. Héros, dégoûté de cette fréquentation lorsqu'il reverra le canapé rouge vendu ou donné provenant de la vieille tante où sont alanguies les filles dénudées.
L'aspect sociologique a été cerné par une auditrice lors de sa lecture de la métaphore filée de la « salle à manger –aquarium » du Grand Hôtel, contre les vitres de laquelle s'écrasent les visages des gens, « de peu », les habitants de Balbec qui ne parviendront jamais à ce luxe étalé sous leurs yeux. Proust dénonce … aussi la riche société décrite, du Boulevard St Germain,- le livre est écrit entre 1905 et 1912 - qui se promène le midi au Jardin d'Acclimatation au Bois de Boulogne avec la description fabuleuse d'une toilette de Madame Swann, l'ex maîtresse (Odette de Crécy), demi-mondaine, épousée, mise quand même au ban de certaines, et qui deviendra, après la mort de Swann, l'épouse d'un ex amant. Les codes sociaux de la riche bourgeoisie ont changé mais je fis remarquer que cette société des réseaux,- des clubs,(du Jockey Club, des Cent, du Country Club, du St James Club) des Cercles ( de l'Etrier, du Pen Club, du Bois de Boulogne, de l'Union Interalliée etc) - existe encore (plus de trois mille actuellement) et que de nombreux diplomates, altiers et fermés entrés dans la « Carrière » portent encore des noms aristocratiques (exception faite de Gary, en raison de son implication en résistance).
Je vous recommande la lecture de l'étude de Mr Bruno Viard qui reprend la cristallisation « De l'Amour » à la Stendhal, ainsi que la décristallisation (Proust); découvrez la à votre tour.
Nous n'avons absolument pas soulevé le fait que pour nourrir la partie hétéro-sexuelle de « A l'ombre des Jeunes filles », André Gide rapportait dans son « Journal » que Proust « lui avouait et se le reprochait, avoir transposé tout ce que ses souvenirs homosexuels lui proposaient de gracieux, de tendre et de charmant, de sorte qu'il ne lui restait plus pour Sodome que du grotesque et de l'abject ». Albertine, on le sait, s'appelait Albert ou Agostinelli ou Lucien Daudet ? L'auteur se trahit notant dans Sodome et Gomorrhe (II) « Le cou d'Albertine qui sortait tout entier de sa chemise, était doré, puissant, à gros grains » ou encore « ce cou puissant que je ne trouvais jamais assez brun ni d'assez gros grains… » Il avouait aussi à Gide « n'avoir jamais aimé les femmes que spirituellement et n'avoir jamais connu d'amour qu'avec les hommes ». (cf. Claude Mauriac in « Proust par lui-même » )
Dans « Le Temps Retrouvé », Proust écrit « la matière de mon expérience serait la matière de mon livre », donc nous voyons des rapports variables selon les moments avec l'autobiographie mais ce n'en est pas une, cependant l'élément biographique lui est nécessaire et fournit l'expérience existentielle, gage d'authenticité. Nous n'avons pas parlé, lors de notre réunion du « je » de quatre personnes , l'homme Marcel Proust, après une vie mondaine, « descend dans un puits » (avis très exact de B. Viard) subit une vie peu intéressante en soi, malade, souffrant, s'enfermant, loin du monde, réclusion après dissipation, l'auteur en tire une expérience spirituelle, intéressante et délègue au narrateur la construction du récit : mise en scène du héros , bien ignorant et faible.
Pour cerner (un peu) la composition, le roman se présente comme un livre de souvenirs, donc de mémoire volontaire « la mémoire de l'intelligence » par exemple lorsqu'il est couché ou involontaire lorsqu'un objet provoque un glissement sémantique du comparant au comparé : (madeleine, cuillère et tasse de thé, clocher semblable à un épi de blé), provoque un phénomène d'illusions, évocateur du passé, source de l'écriture, chez Proust. Les personnages et leurs modifications de situation dans le temps, leur mort, les thèmes multiples comme les arts divers, les lieux innombrables, les modes, etc. ont donné des clés aux écrivains et chercheurs extrêmement nombreux qui se sont penchés sur son œuvre et continuent à le faire. Dans « Le Temps retrouvé », il dit « en rapprochant une qualité commune à deux sensations, l'écrivain dégagera leur essence commune en les réunissant l'une et l'autre pour les soustraire aux contingences du temps, dans une métaphore ».
Le style peut être direct ou indirect, pas seulement technique mais de vision, lié pour lui, à la conception de l'art, ( digressions avec de longues phrases) et se manifeste à plusieurs niveaux, du mot exact, du détail, des enchaînements syntaxiques, des assonances, des allitérations, des cadences poétiques parfois créant « un accent » (préface de Jean Milly), de la structure narrative, à travers la métaphore, i.e. prendre deux termes distincts et à partir d'un élément de sens commun, établir entre eux , une relation étroite. « L'écrivain dégagera alors leur essence commune en les réunissant l'un à l'autre pour les soustraire aux contingences du temps, dan s une métaphore » ( Proust cf. Le Temps retrouvé ).
B.Viard nous précisait que Châteaubriand, Gérard de Nerval, Baudelaire, se servaient des mêmes procédés et que j'ai dit retrouver, personnellement, chez Nathalie Sarraute. Je les ai décrits sur mon papier la concernant lorsqu'elle parle des « Tropismes », ces mouvements indéfinissables qui glissent aux limites de notre conscience, à l'origine de nos gestes, de nos paroles, nos sentiments, (N.Sarraute) « nos simples sensations fugitives et fortuites » pour atteindre aussi « à l'essence de même nature » comme le dit Proust. Je rapproche aussi les grands thèmes appelés par le narrateur Proust « les phrases-types » des « personnages - supports » de Nathalie Sarraute, porteurs d'états que retrouvons en nous-mêmes .
Monique BECOUR